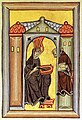Bienvenue sur le Portail de la Mystique. Il donne accès, par thème ou par période, à des articles de Wikipédia touchant à l'histoire de la mystique et aux mystiques du monde. La première section sur l'histoire de la mystique se rapporte principalement à la mystique dans la culture gréco-romaine et chrétienne. La seconde présente des éléments d'autres traditions et courants spirituels aussi couramment qualifiés de mystiques : le soufisme en islam, la kabbale dans le judaïsme et les mystiques orientales. La section suivante est dédiée aux auteurs et chercheurs, qui, sans être nécessairement eux-même des mystiques, ont écrit sur la mystique en sciences sociales, en histoire ou en philosophie. Enfin, des galeries d'images sur des thèmes de la mystique se trouvent tout en bas du portail.
Mystique antique et médiévale
Le nom de « mystique » n'est employé pour désigner une forme particulière de l'expérience religieuse que depuis le XVIIe siècle. Avant, l'adjectif mystique servait surtout à qualifier ce qui a rapport aux « mystères » du christianisme : par exemple le Christ, l'Église ou l'eucharistie ; il qualifiait aussi souvent une forme de théologie d'influence néoplatonicienne, celle que le Pseudo-Denys l'Aréopagite avait développée au VIe siècle dans son traité La théologie mystique. Ce traité aura une grande influence dans le monde latin à partir du XIIe siècle. Ceux que l'on considère aujourd'hui comme les mystiques de l'Antiquité sont les auteurs dont la pensée a un rapport avec celle du peudo-Denys, tandis que les mystiques médiévaux sont principalement les auteurs chrétiens dont les écrits portent sur la médiation et la contemplation des mystères, et ceux qui ont proposé des interprétations de La théologie mystique.
« Trinité suressentielle qui es au-delà du divin, au-delà du Bien, Toi qui gardes les chrétiens dans la connaissance des choses divines, conduis-nous, par-delà l'inconnaissance, vers les très hautes et très lumineuses cimes des écritures mystérieuses. Là se trouvent voilés les simples, insolubles et immuables mystères de la théologie, dans la translumineuse Ténèbre du Silence. »
— Pseudo-Denys l'Aréopagite, Théologie mystique.
Mystique contemporaine | ||||
|
La mystique contemporaine désigne l'ensemble des mystiques, écrivains spirituels et ascètes décédés dans la seconde moitié du XXe siècle, récemment ou bien toujours vivant. | ||||
XXe et XXIe siècle[modifier le code] | ||||
Religieux[modifier le code]Caryll Houselander • Madeleine Delbrêl • Gabrielle Bossis • Pierre Teilhard de Chardin • Howard Thurman • Kenneth Leech • Henri Le Saux• Bede Griffiths • Gerald May • Anthony de Mello • John O'Donohue • Richard Rohr • Sara Grant• Thomas Keating • Wayne Teasdale • Willigis Jäger • Thomas Merton • Marthe Robin • Padre Pio • Adrienne von Speyr • Concepción Cabrera de Armida | ||||
Vocabulaire et notions de la mystique chrétienne
|
Notions : Acédie • Anagogie • Contemplation • Corps mystique • Exercice spirituel • Extase • Hésychaste • Mystère • Noces mystiques • Syndérèse • Théologie mystique • Théologie apophatique |
Courants : Béguines • Devotio moderna • Libre Esprit • Quiétisme • Reclus • |
Théories de la mystique | ||||
— Michel de Certeau, « Mystique », Encyclopaedia Universalis, 1971. | ||||
Sciences sociales[modifier le code]Sociologie : Max Weber • Ernst Troeltsch • Typologie webero-troeltschienne |
Philosophie[modifier le code]« Ceux qui ont lu mon éthique savent que chez moi le fondement de la morale repose en définitive sur cette vérité exprimée dans le Veda et le Vedânta par cette forme mystique Tat twan asi (tout cela, c’est toi) qui s’applique à tout être vivant, homme ou animal, et est dite alors Mahavakya (la grande parole). »
Henri Bergson • Ludwig Wittgenstein • Simone Weil • Georges Bataille • Vladimir Jankélévitch • Stanislas Breton « Le mystique, ce n'est pas le comment du monde, mais le fait de l'existence du monde. »
|
...[modifier le code]
 | ||
Thèmes de la mystique dans l'art
- Extase
-
Extase de Saint François par Georges de La Tour
-
L'Extase de Marie-Madeleine par Paul Rubens
-
L'Extase de Saint Antoine le Grand par Francisco de Goya
- Acédie
-
Saint Jean-Baptiste au désert, Geertgen tot Sint Jans.
-
Mélancholie, Lucas Cranach, 1532.
-
L'Ange de la mélancolie, Albert Dürer.
-
Tentation de saint Antoine, Jan Wellens de Cock.
-
Le moine au bord de la mer, Caspar David Friedrich
-
La Solitude par Théodore Caruelle d'Aligny
- Échelle
-
L'Échelle du paradis, (Jean Climaque), Monastère Sainte-Catherine du Sinaï
-
Giorgio Vasari, Le Songe de Jacob
-
William Blake, Le Songe de Jacob
-
Le Songe de Saint Romuald par Giuseppe Bazzani
-
La Philosophie, rosace nord de la cathédrale de Laon
-
Rembrandt, Le Philosophe en méditation
- Noces mystiques
-
Lettrine d'un manuscrit du Cantique des Cantiques.
-
« Voici que l'époux sort et vient à la rencontre » (Mt, 25,6)
-
Le mariage mystique de sainte Catherine de Sienne par Le Corrège
-
Le mariage mystique de sainte Catherine de Sienne par Pierre Mignard
Les noces mystiques ou mariage spirituel ont une source biblique dans le Cantique des Cantiques. Le verset « Voici que l'époux sort et vient à la rencontre » dans la parabole des vierges sages et des vierges folles de l'évangile de Matthieu est l'une des principales références évangéliques de ce thème. Il a notamment été commenté par Jean de Ruisbroek dans L'ornement des noces spirituelles.
- Visions d'Hildergarde de Bingen
-
Première vision
-
La source de la vie
- La vie du Bienheureux Henri Suso
Portails connexes
- Portail du christianisme
- Portail du catholicisme
- Portail du christianisme orthodoxe
- Portail du protestantisme
- Portail de l’islam
- Portail de la culture juive et du judaïsme
- Portail du monde indien
- Portail des religions et croyances
- Portail de la spiritualité
- Portail du monachisme
- Portail de la Compagnie de Jésus
- Portail de l'Ordre cistercien
- Portail de l'ordre des Prêcheurs